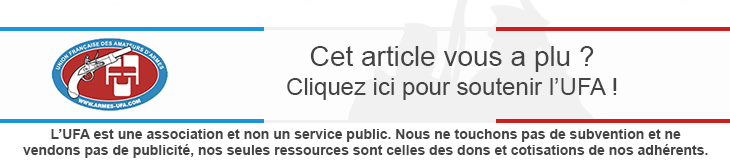Les préfectures sont les représentantes de l’État et les garantes de la légalité républicaine pour assurer une bonne application de la règlementation en matière d’armes : délivrer les autorisations ou les agréments, enregistrer les déclarations et mettre « hors circuit » des armes lorsqu’elles échouent entre des mains « dangereuses » qui pourraient en faire un usage inapproprié. Comme nous sommes dans un état de droit, il y a pour cela, des textes législatifs et règlementaires qui s’appliquent à tous : usager comme administration.
Comme dans toute société humaine, il y a toujours les bons élèves et les moins bons.
En préalable, il convient de souligner qu’un grand nombre de préfectures sont attentives à être équitables et diligentes dans la gestion des autorisations et des déclarations, et sinon font avec les moyens dont elles disposent. Elles communiquent avec amabilité et assistent les déclarants, bref elles facilitent la vie de leurs administrés.
Mais il y a les autres, qui se distinguent par un comportement aux antipodes, par leurs erreurs, la mauvaise foi qui couvre ces erreurs et les motifs arrangés qui enfoncent encore plus le détenteur. Ce sont ces situations dont on se passerait bien et qui, malheureusement, alimentent les conversations dans les milieux des détenteurs d’armes, même si elles ne sont nullement représentatives de l’action de la majorité des administrations.
Dessaisissement ou dépossession virale
Nous vivons dans une drôle d’époque : à l’UFA, nous recevons deux à trois fois par semaine, des appels à l’aide du genre : « Je reçois un recommandé de la préfecture m’enjoignant de me dessaisir de mes armes, et je viens d’apprendre qu’on me supprime mon permis de chasser. Je n’ai jamais rien fait pour provoquer cela, je suis désemparé. Que dois-je faire ? »
Il y existe toute une variété de messages, comportant des menaces de dessaisissement émises par l’autorité administrative. Dans certains cas, mais pas tout le temps, le futur dessaisi a commis une infraction il y a parfois très longtemps. Parfois, cette infraction ne présente aucun rapport avec les armes ou encore elle ne fait pas partie des infractions mentionnées par le CSI , comme incompatibles avec la détention des armes [1].
Cela produit une ambiance très anxiogène qui incite les amateurs d’armes à se couper de leur entourage pour vivre en vase clos, toujours sous la crainte que « le ciel leur tombe sur la tête ».
Dans une circulaire, le Ministère reconnaît de façon explicite des « fragilités juridiques et des différences d’application entre préfectures ». Alors que les restrictions de possession doivent « être limitées à ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public. »
Nous vous donnons quelques exemples de situations réellement vécues (encadré ci-contre) et que nous avons retrouvé dans nos archives.

Les recours contre les décisions
Il y a trois niveaux de recours possible contre ces décisions administratives. Le recours gracieux avec lequel, par une simple lettre à la préfecture, on peut exposer son désaccord en le motivant. Cela peut suffire s’il s’agissait d’un simple quiproquo à dissiper. Puis le recours hiérarchique par lequel on écrit au Ministre de l’Intérieur dont les services l’examinent. A ce stade, il y a 18 % des recours qui font l’objet d’une décision favorable. Et enfin, quand les deux voies des recours précédents sont épuisées, il reste le recours auprès du Tribunal administratif et en dernier ressort le Conseil d’État. Nous n’avons pas de données statistiques sur les affaires résolues par voie judiciaire.
Ainsi, un certain nombre d’affaires trouvent une issue heureuse puisque nous sommes dans un pays libre régi par des lois. Alors, de quoi se plaint-on ? D’abord du fait que ces procédures sont très longues et que pendant ce temps, des armes de prix sont parfois entreposées sans soin, quand elles ne sont pas préventivement détruites voire « égarées », ensuite les honoraires d’avocat se montent parfois à plusieurs milliers d’euros, et la victime de ce dessaisissement aura parfois du mal à débourser une telle somme pour faire reconnaître son bon droit. Dommage ! Car le Ministère est particulièrement attentif au respect des instructions qu’il donne aux préfectures.

Comment cela est-il possible ?
En général, ces évènements désagréables se produisent après un nouvel achat d’une arme déclarée de catégorie C ou à l’occasion du renouvellement d’une autorisation de catégorie B. Probablement parce que c’est à ce moment-là que la préfecture vérifie la présence au TAJ du déclarant ou du demandeur, et que le fichier fait ressortir l’inscription du demandeur. Logiquement, la préfecture doit avant toutes décisions, s’informer sur le dossier judiciaire qui a motivé cette inscription, juger de l’actualité des informations, et ne prendre sa décision qu’ensuite. Lorsque le directeur de la DLPAJ nous avait reçus [2], il nous avait expliqué que le nombre énorme des fiches transférées des deux anciens fichiers STIC de la Police nationale et JUDEX de la Gendarmerie ne permettait pas une vérification totale des informations contenues dans le TAJ. C’est pourquoi il avait ordonné cette vérification chaque fois qu’un nom sortait à l’occasion d’une consultation pour des armes. C’est d’ailleurs ce que recommande une récente circulaire aux préfectures .
Dans cette circulaire, le Ministère recommande aux préfectures de mener une investigation sur les faits judiciaires qui ont conduit à l’inscription au TAJ. Elles ne peuvent pas s’en tenir à la simple inscription, mais doivent « saisir les services de police ou de gendarmerie compétents pour complément d’information » ou bien les procureurs dans le respect du Code de Procédure Pénale. Si les données s’avèrent inaccessibles du fait « d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive », le procureur ne donne pas l’autorisation de consultation du dossier, et la préfecture ne pourra pas utiliser la « mention du TAJ pour fonder sa décision », la préfecture devra réexaminer le dossier et annuler la décision d’inscription « si aucun autre élément défavorable ne ressort de leur dossier. »
En résumé : les préfectures gardent un pouvoir d’appréciation et doivent éviter toute automaticité, et le Ministère veille à la protection des tireurs dans leur bon droit.
Alors pourquoi ?
On peut se poser la question de la raison pour laquelle des amateurs d’armes se voient imposer le dessaisissement de leurs armes pour des faits antérieurs aux dispositions actuelles du CSI (2012) ou parfois pour des « peccadilles » n’ayant pas entraîné leur inscription au FINADIA lors du jugement, alors que les instructions ministérielles sont très claires et ne le permettent pas ?
D’abord la circulaire précisant ces points est introuvable pour le grand public, elle ne figure pas sur le site de Légifrance, ainsi n’est-elle pas opposable aux administrations. Rien de surprenant, puisqu’elle ne s’adresse qu’aux préfectures. Mêmes nous, qui sommes rompus à ce genre de recherche, avons eu des difficultés à nous la procurer, alors que nous avions sa date de signature.
Mais aussi parce que, bien qu’elle apparaisse dans un sous-menu sur l’intranet propre aux préfectures, encore faut-il parvenir à la débusquer. Pour toutes ces causes, il semble que cette circulaire soit passée inaperçue pour un bon nombre d’administrations. C’est d’autant plus dommage qu’elle est fort bien faite , et que sa bonne application pourrait éviter 90 % des problèmes ressentis dont se plaignent les citoyens détenteurs d’armes : leur vie s’en trouverait embellie !

Exemples de motifs de dessaisissement. |

|

L’arme du divorce ! |